AFIDEO
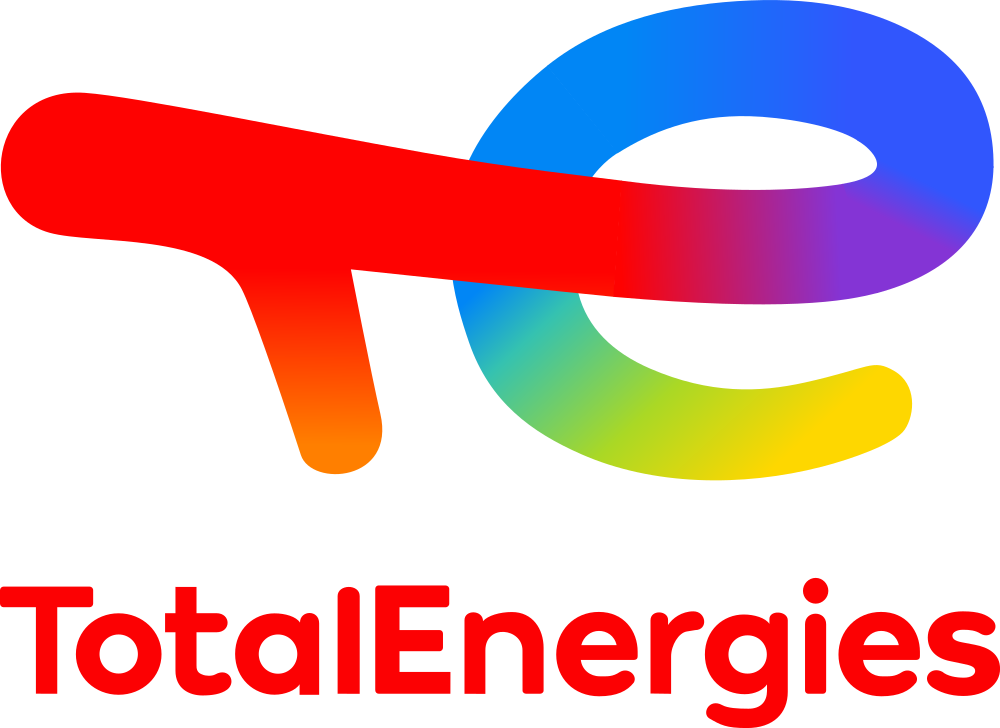
Conférence sponsorisée par TotalEnergies
Pour une écologie de la surditude
Intervenant
Richard NOMBALLAIS
Sourd profond, Richard a traversé les mondes de l’éducation, du médico-social et de l’innovation sociale.
Ancien enseignant à l’INJS (Institut National de Jeunes Sourds), il a ensuite été chef de service à Saint-Jacques, un établissement pionnier dans l’accompagnement des personnes sourdes.
Actuellement, en 2022, il œuvre au sein d’un pôle transversal dédié à la création d’une plateforme de services pour les sourds, avec une approche décloisonnée et inclusive.
Son intervention est philosophique et centrée sur le concept d’écologie de la surditude, qu’il explore à travers des références culturelles, des métaphores, des témoignages et des outils de développement personnel.
Thème principal
Réflexion philosophique sur la surdité et l’inclusion, à travers le concept d’« écologie de la surditude » : comment les personnes sourdes peuvent trouver leur place dans une société normative, performante et parfois excluante, en valorisant leurs expériences, compétences et contributions collectives.
Points clés
1. Écologie de la surditude
Inspirée des travaux de Lavigne et du rapport Meadows (1972).
La surdité ne se réduit pas à une donnée biologique : elle est influencée par les représentations sociales.
L’idée d’« efficience » (plutôt qu’efficacité) est proposée pour valoriser les efforts et les ressources mobilisées par les personnes sourdes.
2. Symboles du parcours sourd
Utilisation du jeu de l’oie comme métaphore : labyrinthe, pont, prison, mer…
Témoignages sur les obstacles rencontrés dans la vie quotidienne, familiale, scolaire et professionnelle.
Notions d’égalité vs équité : importance de compenser les barrières pour atteindre une vraie inclusion.
3. Concept de surditude
Inspiré du « deafhood » de Paddy Ladd.
Approche culturelle et sociale de la surdité, en lien avec d’autres luttes minoritaires (négritude, féminisme).
Critique du validisme et du modèle unique de performance.
4. Modèles écologiques et inclusion
Comparaison entre forêt intensive (uniformité) et forêt Miyawaki (diversité, résilience).
Métaphore du « wood wide web » : réseau d’interdépendance et d’entraide.
Inclusion pensée comme horizontalité, diversité, et co-construction.
5. Les Communs
Ce que les personnes sourdes peuvent apporter à la société : culture visuelle, technologies, authenticité relationnelle, créativité, adaptabilité.
Importance de la pair-aidance, de la cogestion, et de la conscience des rythmes.
Témoignages sur les « ponts » qui ont permis de rebondir, se reconstruire, s’engager.
6. Positionnements identitaires
Trois postures explorées :
Le woke : éveil aux injustices et revendication identitaire.
L’éloge de la faiblesse : acceptation de ses limites et adaptation.
L’inspiration porn : image idéalisée du sourd performant, mais potentiellement aliénante.
7. Vers une écologie symbiotique
S’inspirer du vivant pour construire des réseaux inclusifs.
Valoriser les interactions, les complémentarités, et les expériences partagées.
Développement en trois dimensions : vertical (compétences), horizontal (réseaux), intérieur (connaissance de soi).
Message central
La surdité est une richesse collective et individuelle, à condition de repenser les normes sociales, les modèles de performance et les mécanismes d’inclusion. Cela implique :
De reconnaître la pluralité des parcours et des identités sourdes.
De construire des Communs fondés sur la diversité, la solidarité et la créativité.
De passer d’une logique d’adaptation à une logique de transformation sociale.